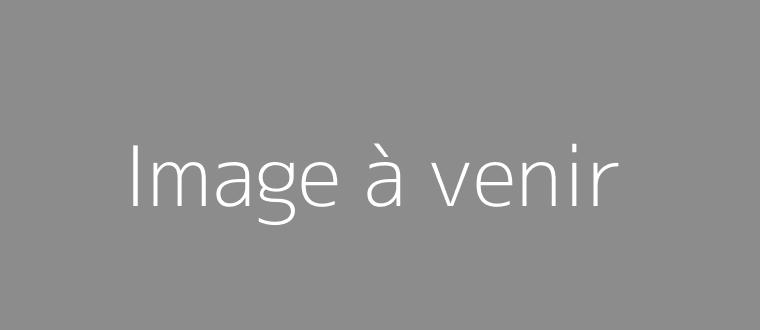Les accidents de plain-pied
On regroupe sous le terme "accident de plain-pied", les
glissades, trébuchements, faux pas et autres pertes d'équilibre.
Ce risque est bien connu dans le secteur sanitaire et
médico-social et supérieur aux autres secteurs d'activités. En
2011 on recensait 6 202 accidents de plain-pied déclarés, qui ont
entraîné 351 026 journées de travail perdues et 337
nouvelles incapacités permanentes.
Ces accidents provoquent des traumatismes allant de la contusion
au décès.
Les situations particulièrement à risques :
- rythme de travail inadapté
- circuits de circulation encombrés
- sols glissants
- présence de produits au sol
- défaut d'éclairage
- co-activité
 Prévenir
ces risques :
Prévenir
ces risques :
- Organiser le travail en y intégrant la contrainte de temps
- Intégrer la prévention dans la conception architecturale
- Limiter au maximum l'encombrement au sol
- Signaler les surfaces en cours de nettoyage, privilégier les produits de nettoyage non glissants
- Limiter les tâches en co-activité
Les risques liés à l'activité physique
Les risques liés à l'activité physique sont la principale source
d'arrêts de travail dans le secteur sanitaire. Ils entrent en
cause dans 75% des cas de maladies professionnelles
déclarées.
Les personnels sont ainsi exposés aux risques de lombalgies, de
TMS ou d'accidents liés notamment aux manutentions répétées de
charges et de personnes.
Les salariés soumis à des efforts physiques brutaux et répétés ou
dépassant leurs capacités de récupération sont alors exposés aux
risques de :
-
 traumatismes
traumatismes
- troubles musculo-squelettiques
- maladies cardio-vasculaires
Ces risques sont accentués en cas d'association avec une fatigue psychologique.
Les situations particulièrement à risques :
- efforts physiques excessifs ou répétés, manutentions manuelles
- gestes répétitifs et /ou exigeant une grande précision
- postures de travail contraignantes
- déplacements à pied longs et répétitifs
- expositions au froid ou au vibration
- contraintes d'organisation du travail
Prévenir ces risques :
- supprimer ou minimiser les manutentions manuelles : équipements d'aide à la manutention, travail sur l'organisation, mise en place d'outils…
- réduire les gestes répétitifs au niveau le plus bas possible : réflexion sur l'organisation et les rythmes de travail
La démarche de prévention des risques devra intégrer le développement des compétences, l'aspect technique (outillage, équipement, aménagement de l’espace) et l'organisation du travail.
Les risques biologiques
En milieu de soins, le risque de contamination par des agents
biologiques est particulièrement élevé : lors du soin, en
laboratoire ou pour la gestion des déchets.
Plus de la moitié des actifs potentiellement exposés aux agents
biologiques travaillent dans le secteur santé-action sociale.
Les agents biologiques sont classés en quatre catégories par
l’article R4421-3 du Code du travail :
- groupe 1 : agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme groupe 2 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs.
- groupe 3 : agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs.
- groupe 4 : agents biologiques provoquant des maladies graves chez l’homme et constituant un danger sérieux pour les travailleurs

L’arrêté du 30 juin 1998 dresse la liste des agents biologiques
des groupes 2, 3 et 4.
L'exposition aux agents biologiques est susceptible de provoquer
une infection, une allergie ou une intoxication. Les agents
biologiques sont des micro-organismes, bactéries, virus, prions
ou agents transmissibles non conventionnels, champignons,
endoparasites humains.
Les modes de contamination
- par voie aérienne
- par pénétration ou contact via la peau et les muqueuses
- par inoculation accidentelle
- par voie digestive
Prévenir les risques :
Si l'exposition à l'agent pathogène ne peut être évitée, il
conviendra de la réduire au maximum en mettant en place des
mesures de protection collective et /ou individuelle.
Les moyens de prévention sont de 3 ordres :
- moyens de prévention organisationnels et techniques
- information et formations aux risques biologiques
- limitation de l'exposition des personnels et suivi médical
L'Accident Exposant au Sang (AES)
 Un accident exposant au
sang (AES) est défini comme le contact avec du sang ou un liquide
biologique contenant du sang et comportant soit une effraction
cutanée (piqûre ou coupure) soit une projection sur une muqueuse
(œil, bouche) ou sur une peau lésée.
Un accident exposant au
sang (AES) est défini comme le contact avec du sang ou un liquide
biologique contenant du sang et comportant soit une effraction
cutanée (piqûre ou coupure) soit une projection sur une muqueuse
(œil, bouche) ou sur une peau lésée.
Les risques infectieux les plus à redouter concernent l’hépatite
B, l’hépatite C et le VIH.
Prévenir les risques de contamination
Les précautions d’hygiène sont à appliquer pour tout patient quel
que soit son statut sérologique. Elles doivent être respectées
par tout soignant lors d’une situation à risque, c’est-à-dire
lors d’un acte présentant un risque de contact ou de projection
avec des produits biologiques, la peau lésée ou une muqueuse.
Les précautions générales d’hygiène ou précautions standards ont
été actualisées dans la circulaire DGS/DH n° 98/249 du 20 avril
1998 relative à la prévention de la transmission d’agents
infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors
des soins dans les établissements de santé.
Lavage des mains
Se laver les mains avant et après chaque soin et immédiatement
après un contact avec du sang ou d’autres liquides biologiques
est la mesure la plus importante pour lutter contre toute
infection. Le lavage se fait en utilisant de l’eau et du savon
désinfectant. On évite ainsi la dissémination de tout agent
infectieux.
Port de gants
Les personnels des établissements de soins doivent porter des
gants dès qu’il y a risque de contact avec du sang, ou tout autre
produit d’origine humaine, ainsi qu’avec les muqueuses ou la peau
lésée du patient. Le port des gants est indispensable à
l’occasion de soins à risque de piqûre (hémoculture, pose et
dépose de voie veineuse, chambres implantables, prélèvements
sanguins…) et lors des manipulations de tubes de prélèvement
biologiques, de linge ou de matériel souillés.
De même, lorsque les mains du soignant comportent des lésions,
des gants doivent être portés lors des soins.
Les gants doivent toujours être changés entre deux patients ou
deux activités. Le port de gants ne dispense pas du lavage des
mains. Il est inutile pour les simples contacts avec la peau
saine (examen du malade, mobilisation, poignée de main).
Port de surblouse, lunettes et masque
Une surblouse, un masque et des lunettes doivent être portés en
cas de risque de projection, d’aérosolisation de sang ou de tout
autre produit d’origine humaine (aspiration, endoscopie, actes
opératoires, autopsie, manipulation de matériel et de linge
souillés).
Matériel piquant ou tranchant
Pour le matériel piquant à usage unique, il convient
de :
- ne pas recapuchonner les aiguilles ;
- ne pas les désadapter à la main ;
- déposer ce matériel dans un conteneur adapté immédiatement
après usage et sans manipulation. Le conteneur doit être situé au
plus près du soin et son niveau maximal de remplissage
vérifié.
Le matériel réutilisable doit être manipulé avec précautions s’il
est souillé par le sang ou tout autre produit d’origine humaine.
Avant toute réutilisation, il faut vérifier qu’il a subi la
procédure d’entretien appropriée (stérilisation ou
désinfection).
Il n’existe pas encore de normes spécifiques pour les dispositifs
médicaux dits de sécurité cependant ils doivent être considérés
comme un moyen de prévention complémentaire. Ces dispositifs
doivent être compatibles avec le matériel déjà existant. Leur
emploi correct dans les services de soins doit être évalué
régulièrement. Les conteneurs pour objets coupants, tranchants
constituent un moyen démontré et indispensable de prévention des
accidents d’exposition au sang.
Les risques liés aux produits chimiques et aux produits Cancérigènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR)
 En 2005, 4,8 millions de
tonnes de substances CMR ont été utilisées en France. Les
produits chimiques sont partout, sous diverses formes, et
particulièrement dans les établissements de soins.
En 2005, 4,8 millions de
tonnes de substances CMR ont été utilisées en France. Les
produits chimiques sont partout, sous diverses formes, et
particulièrement dans les établissements de soins.
L'INVS (Institut National de Veille Sanitaire) estime entre
11 000 et 23 000 le nombre de cas de cancers d'origine
professionnelle survenant chaque année.
La Fiche de Données de Sécurité (FDS)
L'inventaire de tous les produits chimiques présents dans
l'établissement est indispensable. Chaque produit doit être
évalué à la lumière de la FDS (Fiche de Données de Sécurité) qui
doit être communiquée par le fournisseur.
Rappelons que la FDS fournit un nombre important d’informations
concernant les dangers, pour la santé et l’environnement, liés à
l’utilisation du produit. Elle indique également les moyens de
protection à mettre en œuvre, et les mesures à prendre en cas
d’urgence.
Les phrases de risques
Les phrases de risque sont présentes notamment sur les étiquettes
des produits chimiques. Elles indiquent les risques
encourus lors de la manipulation du produit, de son utilisation,
ou de son rejet dans l’environnement. Elles prennent en compte
(dans certains cas) la voie de pénétration dans
l’organisme : contact, ingestion, inhalation. Elles se
présentent sous la forme d’un «R» –ou d’un «H» avec le nouveau
système Classification Labelling Packaging (CLP) suivi de
chiffres, chacun correspondant à un risque particulier.
| Directives DSD/DPD | Règlement CLP | ||
|---|---|---|---|
|
Catégorie 1 |
Mutagène |
Catégorie 1A |
Mutagène |
|
Catégorie 2 |
Catégorie 1B |
||
|
Catégorie 3 |
Mutagène |
Catégorie 2 |
Mutagène |
|
Catégorie supplémentaire |
Pas de pictogramme |
||
Après avoir identifié les voies de pénétration dans l’organisme, il convient de regarder les conditions d’exposition :
- la nature des opérations réalisées ;
- la forme des produits ou matériaux mis en œuvre (liquide, solide, poudre, fibres, gaz...) ;
- les modes d’émission (projection mécanique, système d’évacuation des gaz, volatilisation de liquide...) ;
- les quantités utilisées ou produites ;
- la durée et fréquence d’exposition ;
- l’efficacité des moyens de prévention existants (ventilation générale, captage localisé...) ;
- le nombre de personnes concernées ;
Prévenir le risque
Les mesures de prévention et de protection doivent être
déterminées conformément aux principes généraux de prévention
- supprimer le risque lorsque c’est possible (ex. : changement technique qui supprime l’utilisation de produits chimiques)
- substituer les produits les plus dangereux par des produits moins dangereux, notamment pour les CMR.
Les recherches en matière de substitution des produits CMR doivent être consignées dans le document d’évaluation des risques.
Les rayonnements ionisants
 Les effets des
rayonnements sur l’organisme sont de deux types : on observe
des effets à court terme, dits déterministes (liés directement
aux lésions cellulaires et pour lesquels un seuil d’apparition a
été défini) et des effets à long terme et aléatoires (cancers et
anomalies génétiques).
Les effets des
rayonnements sur l’organisme sont de deux types : on observe
des effets à court terme, dits déterministes (liés directement
aux lésions cellulaires et pour lesquels un seuil d’apparition a
été défini) et des effets à long terme et aléatoires (cancers et
anomalies génétiques).
Ils se manifestent de quelques heures à plusieurs mois ou années
après l’irradiation.
En radioprotection, comme dans d’autres domaines, il est
primordial d’intégrer la sécurité le plus en amont possible,
prenant en compte tous les aspects (organisationnels,
opérationnels, chimiques, ionisants…).
Pour des situations existantes, comprenant des risques
d’expositions externes ou de contamination, il est indispensable
de passer une phase d’évaluation et de quantification du risque
puis vérifier que les mesures de radioprotection sont bien
appliquées et que les doses d’exposition ne dépassent pas les
valeurs réglementaires établies. Si le danger radioactif est lié
à la présence de sources radioactives, le risque «rayonnements»,
lui, est invisible et impalpable. Le repérage rigoureux des zones
à risque d’exposition et des sources revêt donc une importance
particulière. Des murs ordinaires ou des cloisons ne sont pas un
obstacle à la propagation de certains rayonnements ionisants. De
plus, ceux-ci peuvent être réfléchis et diffusés par les murs,
sols ou plafonds.
La délimitation de zones, définies en fonction de l’exposition
potentielle aux rayonnements ionisants, permet de hiérarchiser
les niveaux de dangerosité des lieux de travail sur lesquels sont
utilisées des sources de rayonnements ionisants. Un arrêté
(arrêté du 15 mai 2006) précise les conditions de délimitation de
ces zones compte tenu de niveaux de référence correspondant à des
doses délivrées en 1 heure, ainsi que les règles d’hygiène, de
sécurité et d’entretien qui y sont imposées, ainsi que les règles
d’accès et d’affichage.
Les risques psychosociaux (RPS)
 On regroupe sous le terme
risques psychosociaux diverses situations de mal-être pouvant
avoir des causes très variées : surcharge de travail,
contrainte excessive de temps mais aussi pertes de repères,
difficulté à trouver du sens au travail, conflits de
valeurs...
On regroupe sous le terme
risques psychosociaux diverses situations de mal-être pouvant
avoir des causes très variées : surcharge de travail,
contrainte excessive de temps mais aussi pertes de repères,
difficulté à trouver du sens au travail, conflits de
valeurs...
Les RPS sont classés en 3 catégories correspondant à des
définitions, conditions d'exposition et modalités de prise en
charge différentes : le stress, la violence et le
harcèlement.
Les accords nationaux interprofessionnels sur le stress au
travail du 8 juillet 2008 et sur le harcèlement et la violence au
travail du 26 mars 2010 les ont définis de la manière
suivante :
- Stress : «état survenant lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face»;
- Harcèlement moral : «agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel»
- Violence au travail : «toute action, tout incident ou tout comportement qui s’écarte d’une attitude raisonnable par lesquels une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou du fait de son travail»
Les effets des RPS sur la santé sont physiques (fatigue,
douleurs, troubles du sommeil, de l'appétit…), émotionnels
(irritabilité, sensibilité excessive, angoisse, sensation de
mal-être...) , comportementaux (agressivité, repli sur soi…) et
intellectuels (oubli, difficultés à se concentrer, à pendre des
décisions, et des initiatives…).
On estime également que les RPS seraient en cause dans
l'apparition de dépression, burn-out, TMS, maladies
cardio-vasculaires, AVC et crises cardiaques. Enfin, le suicide
est l’expression la plus violente et définitive de
l’impossibilité de l’individu à faire face à la situation
Analyser l'environnement de travail sous l'angle des
risques psychosociaux
La DARES a défini six dimensions de risques psycho-sociaux :
- Les exigences du travail : la quantité de travail, la pression temporelle (devoir travailler trop vite ou de manière hachée), la complexité du travail (devoir penser à trop de choses à la fois), la difficulté à concilier travail et obligations familiales.
- Les exigences émotionnelles : travail en contact direct avec le public, contact de la souffrance, peur au travail, agressions verbales ou physiques.
- Le manque d’autonomie et de marge de manœuvre : une forte demande psychologique combinée à une faible latitude (job-strain), l’impossibilité de déployer ou de développer ses propres compétences, de donner son avis ou exprimer ses attentes vis-à-vis du travail.
- Le manque de soutien social ou de reconnaissance au travail : entraide entre collègues, soutien des supérieurs, reconnaissance du travail, utilité du travail, clarté du management.
- Les conflits de valeurs : opposition, ou non, à des normes professionnelles (qualité empêchée), sociales, ou à des valeurs personnelles (conflits éthiques).
- L’insécurité de l’emploi et du travail : peur de la perte d’emploi, de devoir changer de qualification ou de métier, capacité à faire le même travail jusqu’au départ en retraite.
L’ANACT propose une analyse en quatre domaines de tension et régulation :
- Les exigences du travail et son organisation : contraintes entre les objectifs de travail et les moyens mis à disposition, entre le niveau de prescription et les marges de manœuvre possibles, entre les efforts exigés et les possibilités de récupération ; degré d’exigence du travail en matière de qualité ; pression temporelle ; complexité ; vigilance et concentration requises; injonctions contradictoires ; autonomie dans le travail ; prévisibilité ; marges de manœuvre procédurales ; exigences émotionnelles : relation avec le public, contact avec la souffrance, peur au travail.
- Le management et les relations de travail : nature et qualité des relations avec les collègues, les supérieurs : soutien social, reconnaissance, rémunération, justice organisationnelle.
- Les valeurs et attentes des salariés : conciliation entre vie professionnelle et vie privée, entre les attentes individuelles de parcours professionnels et les exigences de l’établissement à court terme. Utilisation et développement des compétences, conflit d’éthique.
- Les changements du travail : Nouveau système d’information, réorganisation du service, restructuration de l’établissement, nouvelles technologies, insécurité de l’emploi.
Prévenir les risques psychosociaux
L'employeur doit intégrer la prévention des RPS dans le Document
Unique au même titre que les autres risques, la difficulté étant
que les RPS ont une incidence individuelle et collective
Pour chaque situation-problème identifié, il s'agira de définir
les actions à engager aux 3 niveaux de prévention :
- prévention primaire : combattre le risque à la source
- prévention secondaire : gérer les risques
- prévention tertiaire : prendre en charge les salariés