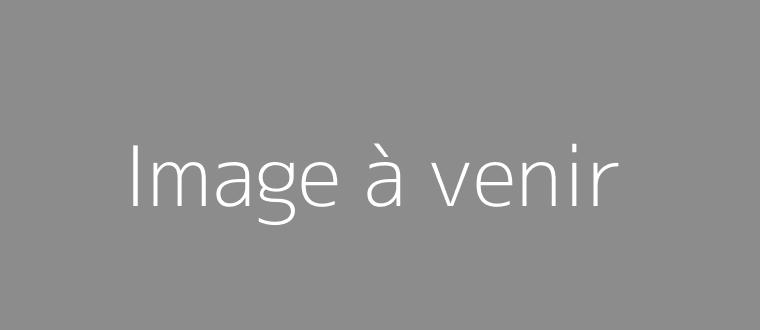Claude-Emmanuel Triomphe, Directeur Europe, ASTREES (Association Travail Emploi Europe Société) exprime comment l’augmentation des risques psychosociaux est étroitement liée à la vague récurrente de réorganisations et restructurations.
La santé au travail relève d’une triple dimension : le bien-être
physique, mental et social.
Notre association travaille sur beaucoup de choses, sur les
mutations du travail et de l’emploi liées au social en France et
en Europe.
Je vais saisir une série de travaux que nous avons conduits
depuis l’année 2008 : « health and restructuring »,
santé et restructuration dans les services privés et publics.
Aujourd’hui, penser la question de « l’organisation » du travail
ne peut pas être abordé sans penser à la vague récurrente de «
réorganisations » et « restructurations ».
Les restructurations ce n’est pas seulement les réductions
d’effectifs, les plans sociaux. C’est également les questions
d’externalisation, de sous-traitance, de fusion, d’acquisition,
de mobilité interne et de réorganisation interne.
Notre enquête, réalisée avec nos partenaires européens, montrait
par exemple que le secteur des soins de santé est aujourd’hui le
plus touché par la question de l’intensification du travail. Une
autre enquête française menée par le groupe Malakoff-Médéric
montre que, par exemple aujourd’hui, dans les entreprises de plus
de 500 salariés, on note une augmentation de la fréquence des
réorganisations et des restructurations.
 Des travaux sur la conséquence de la perte
d’emploi indiquent que cela n’induit pas seulement du stress
psychologique, de la dépression et de l’anxiété, qui ne sont déjà
pas rien, mais également des troubles du sommeil, une perte de
l’estime de soi et de la stabilité affective.
Des travaux sur la conséquence de la perte
d’emploi indiquent que cela n’induit pas seulement du stress
psychologique, de la dépression et de l’anxiété, qui ne sont déjà
pas rien, mais également des troubles du sommeil, une perte de
l’estime de soi et de la stabilité affective.
Deuxièmement, nous avons réalisé une série de travaux sur les
suites des restructurations. Une augmentation du travail
temporaire ou à durée limitée dégrade les conditions de santé.
Une troisième série de travaux a démontré que, dans les réorganisations ou restructurations, ceux qui restent ne sont pas les plus chanceux d’un point de vue de la santé. Une série de travaux montre combien les « survivants » souffrent parfois autant, voire même plus, que ceux qui partent, en tout cas sous l’angle de la santé.
La France est en retard sur la question des risques psychosociaux
Dans tous les pays européens, les entreprises et les entités
publiques, ont bien sûr des responsabilités légales sur la santé
des salariés, avec des systèmes assez précis de surveillance.
Cependant, des pays sont très avancés comme les pays du Nord ou
même l’Allemagne, voire l’Angleterre. La France se situe dans une
moyenne et pas en tête de peloton.
Nos évaluations des risques sont menées de manière très
variable : Monsieur Benlezar parlait de son Document Unique
dont je ne doute pas que chez Air France, il mène à des plans
d’action, mais qui, dans combien de pays, le Document Unique
c’est simplement des papiers qui ne servent à rien.
Je rappelle quand même que l’Europe a été pilote sur ce qui
concerne le stress, le harcèlement et la violence dans le
travail, qui a été traduit en France dans des accords
interprofessionnels ou bien les recommandations du dernier
rapport de 2010 de Monsieur Lachmann, Madame Penicaud et Monsieur
Larose sur le bien-être et l’efficacité au travail.
La question santé et restructuration n’est pas la question des
professionnels de la santé au travail. C’est-à-dire que si c’est
le cas, c’est terminé. Pourquoi ? Parce que cela veut dire
que le management d’une entreprise n’aura pas vu la question et
ne l’aura pas traitée, n’en aura pas fait une priorité. Non pas
simplement par conscience morale, mais parce qu’il y va tout
simplement de la compétitivité globale des organisations.
Dans le secteur public, on est encore largement sous l’angle du
déni. C’est-à-dire qu’on dit qu’il faut réorganiser et on ne se
pose même pas la question des effets. Le management, dans le
secteur public, est, parfois, encore plus éloigné de la
conscience de ces problèmes que peut parfois l’être le management
dans le secteur privé, d’autant qu’on lui demande, en même temps,
de conduire cela avec une certaine éthique du service public.
Jusqu’à présent, on a voulu faire en sorte que les
restructurations du secteur public ressemblent complètement à
celles du secteur privé en disant : « c’est ça, la bonne
méthode. » Je n’en suis pas sûr.