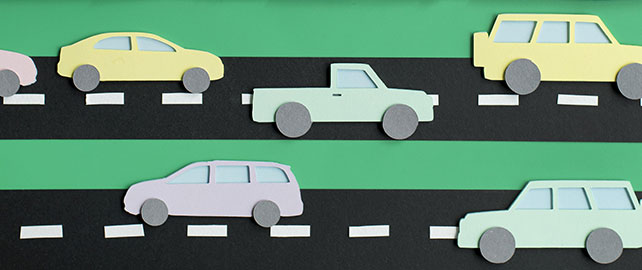|
L’une des trois missions confiées
par la loi du 17 juillet 2001 (art 31) au Fonds national de
prévention de la CNRACL, élaborer des recommandations
d’action en matière de prévention à l’intention des
collectivités, est appelée à se développer dans les
prochaines années.
Deux approches complémentaires : comment caractériseriez-vous la logique du juge et celle du juriste ?
Guy BARATHIEU
: Le rôle de l’universitaire est de
travailler sur la doctrine, étudier les lois et analyser la
manière dont les juges les appliquent. Sa fonction
pédagogique lui permet (en théorie), via l’enseignement
qu’il dispense, d’influer sur l’application de la loi et la
jurisprudence. L’universitaire intervient davantage en
amont de la démarche alors que le juge sanctionne un
manquement à la règle. Fonctions publiques territoriale et hospitalière : deux mondes. Quels sont les points communs et les différences statutaires ?
Guy BARATHIEU
: Les règles du travail sont les mêmes
qu’il s’agisse du secteur public ou des entreprises privées
(Partie IV du Code du travail). Nous retrouvons des
fonctions analogues. Ce sont les règles d’organisation qui
diffèrent. Traditionnellement, la fonction publique
hospitalière se rapproche du secteur privé ; son
fonctionnement est proche d’une gestion d’entreprise.
L’organisation de la santé au travail est régie par le code
du travail en ce qui concerne la fonction publique
hospitalière et par le Statut de la Fonction public pour
les collectivités territoriales. On parle de CHSCT pour la
première et de CHS pour la seconde ; pourtant les
missions sont les mêmes. Peut-on s’appuyer sur la jurisprudence pour apprécier la responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction ?
Guy BARATHIEU
: Oui nécessairement. La jurisprudence est
significative de l’application du droit. Elle est
éclairante quant à la façon dont on doit se comporter. Le
travail de l’universitaire est ici intéressant. De par le
résumé et l’analyse d’une situation donnée, il permet de
donner un fil conducteur au préventeur. Comment envisager une organisation santé sécurité ou un système, qui assure une répartition des responsabilités de manière juste ?
Guy BARATHIEU
: En matière pénale et au contraire du
civil, la responsabilité ne se partage pas (mais un
accident peut avoir plusieurs causes et donc plusieurs
fautifs). L’important est de respecter le sens des textes
sans s’enfermer dans un formalisme étroit. Un
exemple : le décret d’hygiène sécurité de 1985 prévoit
la mise en place d’un ACMO dans chaque collectivité,
qu’elle emploie 500 ou 12 000 agents. On constate aisément
que la situation n’est pas la même et doit être adaptée. Il
serait peut-être pertinent de modifier également le titre
d’ACMO, qui donne l’impression d’être responsable alors
qu’il s’agit d’un conseiller et d’un animateur sécurité.
L’arrêté définissant la fonction d’ACMO ne prend pas
suffisamment en compte la spécificité des situations (de
plus, c’est une fonction et non pas un emploi statutaire).
Dans les fonctions publiques, la réglementation devrait
être plus précise et demander la mise en place de solutions
sur-mesure. Pensez-vous qu’il faut réserver la fonction d’ACMO (et l’équivalent chez les hospitaliers) à des spécialistes hautement qualifiés ?
Guy BARATHIEU
: Pas forcément. Mais il est sûr que la
compétence et le statut des ACMO doivent être renforcés.
Des ACMO de terrain, dotés de compétences techniques et
relationnelles pointues, existent déjà dans les grosses
collectivités mais ce sont rarement des professionnels à
temps plein. Comment favoriser la prise de conscience par les décideurs de leur responsabilité ? La diffusion de recommandations constitue-t-elle un moyen ?
Guy BARATHIEU
: Il est primordial de donner des
moyens professionnels aux différents intervenants. Par
exemple, un maire qui fait appel à un inspecteur et
prévient tous les services de son passage et de ses
préconisations à valeur obligatoire donne à celui-ci un
vrai pouvoir de contrôle, suivi d’effets. Il est donc
nécessaire de renforcer la sensibilisation des élus sur les
questions d’hygiène sécurité et de leur faire prendre
conscience de l’impact sur la performance ou le taux
d’absentéisme… A ce titre, des recommandations, relayées
par un arrêté ministériel, existent déjà dans le privé
(CRAM). Il serait bon de faire évoluer les choses pour que
cela soit mis en place dans la fonction publique. L’une des missions du FNP porte sur l’élaboration de recommandations. Quelle valeur ou portée juridique pourrait avoir les recommandations émises par la CNRACL ?
Guy BARATHIEU
: Un tel texte n’est pas une obligation
mais pourrait donner lieu à responsabilité dans le cadre de
la jurisprudence. Rien n’empêche, par ailleurs, la CNRACL
d’émettre des recommandations mais sa compétence n’est pas
de réglementer. En outre, depuis la loi de
décentralisation, les collectivités sont autonomes (même si
elles dépendent du ministère de l’intérieur). M. CREVEL, pour la préparation de votre étude, vous avez rencontré des collectivités et établissements hospitaliers, pourriez vous résumer en quelques mots votre impression ?
Samuel CREVEL
: Pour les besoins de l'étude, j'ai
effectivement rencontré des directeurs de centres de
gestion et des responsables d'établissements publics de
santé. L'époque me semble plus que jamais à la mise en place de dispositifs efficaces de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le FNP est devenu assurément, de par les moyens qu'il déploie pour accompagner les collectivités et établissements publics dans cette démarche, un acteur majeur en la matière.
|