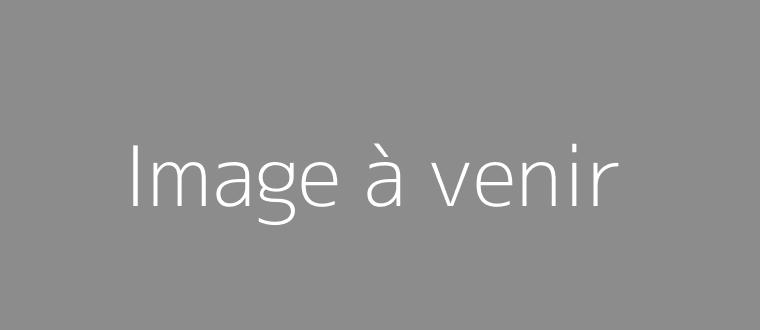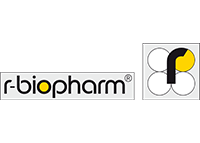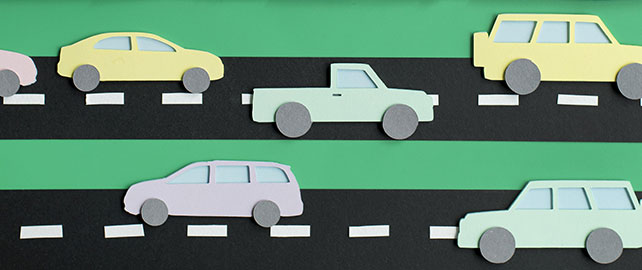Son développement conduit en pratique à une responsabilité civile quasi-automatique, ce qui invite à s’interroger sur ses implications en matière pénale, et à combattre certaines idées reçues.
1. L’obligation de sécurité pèse sur l’employeur et le chef d’entreprise
L’accent mis aujourd’hui sur l’obligation de résultat entraîne chez bon nombre de dirigeants d’entreprises le sentiment que quoi qu’il arrive,sa responsabilité sera de toute façon engagée et que même à l’impossible, il sera tenu... Or, l’attitude « fataliste » peut créer les conditions du risque. Il importe donc de bien comprendre les mécanismes applicables, sachant qu’une même situation peut conduire à différents types de responsabilités.
Au plan de la responsabilité civile, c’est celle de l’employeur (personne morale dans l’immense majorité des cas) qui sera recherchée par la victime, notamment sur le terrain de la faute inexcusable afin d’obtenir devant le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale la réparation des préjudices non indemnisés dans le cadre de la législation ATMP.
Au plan pénal, les poursuites visent à faire sanctionner les atteintes aux valeurs sociales protégées par le Code du travail (la sécurité des salariés) et par le Code pénal (la vie et l’intégrité physique d’autrui). La responsabilité pèse ici au premier plan sur le chef d’entreprise (personne physique), dans la mesure où il est tenu de veiller personnellement à l’application des règles destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs placés sous son autorité. Certes, dans sa version recodifiée en 2008, le Code du travail entretient une certaine confusion en utilisant de manière uniforme le terme d’« employeur ». Le chef d’entreprise reste néanmoins « en première ligne » dans la mesure où le pouvoir de direction dont il est investi fonde sa responsabilité (l’obligation de sécurité du salarié étant quant à elle secondaire et d’une nature différente). Cette responsabilité pénale du chef d’entreprise est cumulative avec la responsabilité de la personne morale employeur, laquelle n’est pas une responsabilité du fait d’autrui mais « par représentation », impliquant pour les juges de caractériser une infraction commise pour son compte par l’un de ses organes ou représentants (C. Pén., art. 121-2). Point positif pour les entreprises, la jurisprudence semble évoluer vers une plus grande rigueur d’analyse en la matière (cf. Cass. Crim. 2 oct. 2012, n° 11-84415). En revanche, une simple faute d’imprudence suffit pour entraîner une condamnation de la personne morale.
2. L’obligation générale de sécurité, avec ou sans dommage ?
L’obligation de sécurité impose un résultat à l’employeur, à savoir la protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs. Après avoir eu un ancrage contractuel (cf. Cass. Soc. 28 février 2002, n° 00-10051), la jurisprudence fonde aujourd’hui l’obligation de sécurité dans l’article L4121-1 du Code du travail selon lequel « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ». La jurisprudence sociale interprète aujourd’hui cette obligation à la lumière de la Directive CE no 89/391 du 12 juin 1989 et considère que « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité » (Cass. Soc. 28 février 2006, n° 05-41555).
L’absence d’accident ou de dommage ne suffit pas à atteindre le résultat. L’obligation de sécurité a « muté » et permet ainsi de sanctionner l’employeur en cas de préjudice d’exposition à un risque (cf. Cass. Soc. 11 mai 2010, n° 09-42241 ; Cass. Soc. 16 octobre 2010, n° 08-45609), ou de lui interdire de prendre des mesures, notamment organisationnelles, qui seraient de nature à compromettre la sécurité et/ou la santé physique et mentale de ses salariés (cf. p. ex. Cass. Soc. 5 mars 2008, n° 06-45888 ; Cour d’appel de PARIS, Pôle 6 chambre 2, 13 décembre 2012, n° 10/00303). De son côté, la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut traditionnellement être engagée même en l’absence de dommage, en cas de non-respect d’un texte édictant des prescriptions de sécurité ou de prudence. C’est ce que l’on appelle les infractions formelles (cf. p. ex. le délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui réprimée par l’article 223-1 du Code pénal).
En cas de fait accidentel, celui-ci donne généralement lieu à une situation de concours d’infractions, dans laquelle il est reproché au dirigeant de l’entreprise un délit de blessures ou d’homicide par imprudence, doublé d’une violation de règles de sécurité. Cela étant, il est jugé qu’en l’absence de violation d’une règle particulière de sécurité ou de prudence prévue par le Code du travail, la seule violation de l’obligation générale de sécurité n’est pas répréhensible que ce soit au titre du délit prévu à l’article L4741-1 du Code du travail, qui suppose pour le chef d’entreprise la méconnaissance d’un texte (Cass. Crim. 30 octobre 1990, n° 89-84718), ou du délit de mise en danger de l’article 223-1 du Code pénal (Cass. Crim. 17 septembre 2002, n° 01-84381).
3. Une obligation générale de sécurité qui pèse lourd en cas d’infraction d’imprudence
En matière de délit de blessures ou d’homicide par imprudence, la
mécanique de l’article 121-3 du Code pénal impose au juge
correctionnel de motiver sa décision en caractérisant le critère
1/ de causalité (la personne physique poursuivie est-elle auteur
direct ou indirect du dommage ?) et 2/ de gravité (sous
l’angle ici de la faute et non du seul dommage).
L’obligation générale de sécurité vient alors faire irruption
dans l’analyse :
- Lorsque le chef d’entreprise (ou son délégataire) n’a pas causé directement le dommage mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qu’il n’a pas pris les mesures permettant de l'éviter, sa responsabilité pénale en tant qu’auteur indirect suppose que soit établi à son encontre une faute dite qualifiée. Les tribunaux correctionnels retiennent plus volontiers ici la notion de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer » que celle de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Au regard du principe de légalité et d’interprétation stricte de la loi pénale, la violation de l’obligation générale de sécurité peut constituer une faute « caractérisée » en cas de manquement isolé mais suffisamment grave dans le contexte, ou bien, d’accumulation de fautes légères. Force est de constater que la conscience du risque est quasi-présumée lorsque l’auteur de la faute est un professionnel.
- Lorsque le chef d’entreprise ou son délégataire est considéré comme l’auteur direct du dommage (ce qui est rare en pratique), la violation de l’obligation générale de sécurité peut caractériser une faute d'imprudence, sachant que la simple faute est punissable dans ce cas.
L’enjeu va être d’établir si le prévenu a ou non accompli, au regard notamment de son obligation de sécurité, les diligences normales de sécurité compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Ces diligences sont appréciées d’autant plus strictement que le chef d’entreprise est un professionnel.
3. Etre relaxé n’exclut pas la condamnation de l’entreprise
Au plan pénal, la charge de la preuve des éléments constitutifs
de l’infraction de blessures ou d’homicide par imprudence incombe
au Ministère public (le Procureur de la République ou son
substitut).
Au plan civil, malgré ce que les statistiques peuvent laisser
penser, la faute inexcusable doit être prouvée
par la victime et ne se présume pas (sauf exceptions prévues aux
articles L4131-4 et L4154-3 du Code du travail). Contrairement à
d’autres domaines, où l’obligation de sécurité de résultat peut
être sanctionnée même en l’absence de faute de la part de
l’employeur (p. ex. en matière de harcèlement moral – cf. Cass.
Soc. 3 février 2010, n° 08-44019), la faute inexcusable implique
comme son nom l’indique de caractériser un manquement (cf. CSS,
L452-1). La jurisprudence applique invariablement la règle
suivante : le manquement à l’obligation de sécurité à
l’origine d’un accident du travail ou de maladie professionnelle
constitue une faute inexcusable, « lorsque l'employeur
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé
le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour
l'en préserver ». Trois conditions sont requises :
1/ la conscience du danger (qui mériterait selon nous d’être
distinguée de la notion de risque bien que la jurisprudence ne
paraisse pas y attacher d’importance), 2/ la carence ou
l’inaction face au danger et 3/ un lien de causalité nécessaire
avec l’accident, le manquement n’ayant pas à en être la cause
déterminante (d’où la difficulté pour l’employeur à
s’exonérer en invoquant une faute de la victime, aussi
grave soit-elle, à moins que celle-ci soit la cause exclusive de
l’accident).
Point délicat, l’évaluation des risques peut ici intervenir à
contre-emploi, comme indice que l’employeur avait connaissance du
danger. En tout état de cause, il est toujours aisé a
posteriori de se mettre à la place d’un professionnel
normalement avisé et diligent et de considérer que
l’employeur avait ou « aurait dû » avoir
conscience du danger et n’a pas pris les mesures appropriées.
On retrouve ainsi certains traits communs avec la définition de
la faute pénale d’imprudence et la méthodologie applicable
concernant les diligences normales de sécurité.
Il est certain qu’une condamnation pénale de l’employeur vient
toujours faciliter grandement cette démonstration pour la victime
ou ses ayants droit, sachant que la juridiction civile doit
s’aligner sur la décision pénale concernant l’appréciation de la
faute et du lien de causalité.
Cela étant, l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal
n’est plus absolue sachant que la loi Fauchon n° 2000-647 du 10
juillet 2000 a mis fin à l’identité entre la faute pénale et la
faute civile. La victime reste ainsi en droit d’exercer
un recours indemnitaire au titre de la faute inexcusable de
l’employeur ou de la personne qu’il s’est substitué dans la
direction du travail, même si le Tribunal correctionnel a
prononcé la relaxe du prévenu au titre d’une infraction
d’imprudence (cf. C. Proc. Pén., art. 4-1). La
jurisprudence impose de rechercher si les éléments du dossier
permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur,
laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs
de l'infraction d'homicide involontaire (Cass. Civ. II 15 mars
2012, n° 10-15503).
Conclusion
La sévérité des décisions judiciaires repose sur une logique
binaire : inciter à une prévention effective par la
certitude de lourdes sanctions en cas de manquement. Cela étant,
à trop focaliser l’attention sur l’obligation de
résultat, le risque est d’éluder la démarche d’analyse et de
qualification juridique des faits. Cette tendance à la
simplification est réductrice et mérite d’être combattue, y
compris parfois devant les prétoires.
En effet, la connaissance de ces mécanismes de responsabilité et
de leur articulation constitue un outil de prévention, permettant
aux décideurs de prendre en toute connaissance de cause les
mesures appropriées sur le plan technique, humain et
organisationnel.
En effet, les condamnations sont bien souvent liées à une
organisation jugée défaillante ou à des dysfonctionnements
imputables in fine au chef d’entreprise.
Plus que jamais, celui-ci ne peut donc se contenter de simplement
rechercher la conformité réglementaire ; il doit aussi et
surtout organiser la prévention dans l’entreprise autour d’une
véritable politique intégrée tenant compte des principes généraux
de prévention (C. Trav. L4121-2) et impliquant au quotidien
toutes les fonctions et services de l’entreprise.
Si certains instruments juridiques tels que la délégation de
pouvoirs ou l’assurance contre la faute inexcusable peuvent
s’avérer précieux, voire indispensables, développer la
maîtrise des risques et la « culture
sécurité » reste le meilleur rempart de l’employeur
au plan de ses responsabilités.