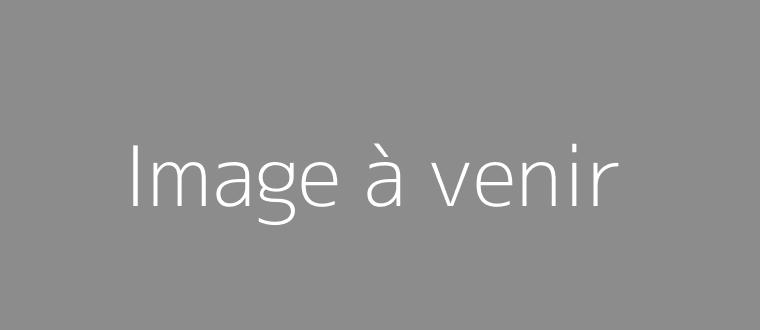Ces pratiques de coopération ont permis souvent de faire émerger
une forte culture sécurité partagée.
Elle se sont développées historiquement sur de nombreux
territoires, au travers de formules diverses, faute d’un cadre
juridique spécifique permettant d’appréhender ces formes de
mutualisation collective.
1. La mise en place d’un nouveau cadre juridique spécifique pour les plateformes industrielles
Soucieux d’améliorer l’attractivité des sites industriels en
France, le législateur vient de mettre en place un nouveau cadre
juridique spécifique aux plateformes industrielles, permettant
aux exploitants de bénéficier de certaines adaptations de la
réglementation environnementale (cf. loi PACTE n° 2019-486 du 22
mai 2019, art. 114, et décret n° 2019-1212 du 21 novembre
2019).
Après des décennies de déclin industriel, il est opportun que les
pouvoirs publics amorcent une évolution pour préserver et
améliorer les capacités industrielles en France, qui participent
de notre souveraineté économique et sociale, ce qui est
parfaitement conciliable avec la recherche du meilleur niveau de
sécurité collective.
A cet égard, précisons que l’esprit de cette réforme n’est pas
ici d’atténuer la responsabilité des exploitants en matière de
risques, d’autant qu’elle s’inscrit dans un contexte de débat sur
la sécurité industrielle et de vigilance des autorités de
contrôle (cf. Instruction ministérielle du 31 décembre 2019 sur
le programme d’action national de l’Inspection des installations
classées pour 2020).
2. La mise en place d’un contrat de plateforme
Concrètement, le nouveau dispositif prévoit la possibilité pour
des exploitants regroupés en plateforme, de solliciter
l’inscription sur une liste nationale, selon une procédure
administrative dédiée impliquant l’échelon préfectoral et
ministériel.
Elle est ouverte aux plateformes industrielles, définies
dorénavant comme « le regroupement d'installations (…) [classées
pour la protection de l’environnement – ICPE] sur un territoire
délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la
complémentarité des activités de ces installations, à la
mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui
leur sont nécessaires » (C. Env., L515-48).
Pour cela, les exploitants qui souhaitent se regrouper dans ce
cadre doivent s’engager conjointement au travers de la conclusion
d’un « contrat de plateforme » sui generis, dont l’objet est de
définir :
- Les domaines de responsabilité relevant du périmètre de gestion mutualisée ;
- Un responsable, dénommé « gestionnaire de plateforme » (qui doit obligatoirement être choisi parmi les personnes morales de droit français exploitantes d'au moins une des installations regroupées) ;
- Ses limites de compétences dans chaque domaine délégué (qui viennent s’ajouter à ses propres responsabilités en tant qu’exploitant d'installations classées pour la protection de l'environnement) ;
- Les conditions d'évolution de la composition de la plateforme (entrées/ sorties d’exploitants) ;
- Les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités confiées, en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.
3. Des engagements spécifiques pour les établissements à hauts risques regroupés
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les établissements
classés SEVESO dans lesquelles des substances, préparations ou
mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils
peuvent être à l'origine d'accidents majeurs, ainsi que ceux
soumis à plan de prévention des risques technologiques (cf. C.
Env., R515-118).
A noter que ces dispositions s’inspirent de la doctrine
administrative fixée par l’ancienne circulaire du 25 juin 2013
relative au traitement des plateformes économiques dans le cadre
des PPRT, qui constituait jusqu’alors le seul cadre juridique
spécifique. Précisons au passage qu’en cas d’inscription sur la
liste nationale, ces établissements seront réputés constituer un
ensemble pour l’application de la réglementation sur les
PPRT.
Tout d’abord, pour ces établissements, le contrat de plateforme
doit préciser spécifiquement les modalités de prise en charge des
effets des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de
la plateforme. Ces règles s’appliquent dans les rapports entre
les parties, mais n’affectent pas les droits des tiers extérieurs
(riverains, etc.) en cas de nuisances ou de pollution par
exemple.
Ensuite, si le contrat de plateforme prévoit que la prévention et
la gestion des accidents majeurs relève du domaine de
responsabilité géré de manière mutualisée, ces exploitants
doivent également formaliser une déclaration à joindre au dossier
de demande d’inscription. Celle-ci a pour objet de préciser les
engagements de chaque partenaire en matière :
- De sécurité des procédés ;
- D’hygiène et sécurité au travail ;
- De protection de l’environnement ;
- De droit à l'information ;
- De participation aux opérations collectives de sécurité, dont
la liste vient d’être fixée par un arrêté du 9 décembre 2019
(applicable à compter du 12 janvier 2020).
Celles-ci regroupent 6 items d’obligations :
- La consultation préalable mutuelle avant la remise à l’administration d’une étude de dangers ou d’un plan d’urgence ;
- Le partage des retours d’expérience concernant les incidents et accidents survenus ;
- La rédaction de procédures d’urgence coordonnées, et la réalisation sur une base au moins annuelle d’un exercice coordonné et simultané, placé sous la direction du gestionnaire de la plateforme ;
- La gestion et maintenance des équipements communs de protection individuelle requis par ces procédures ;
- L’information de l’ensemble des personnels sur l’ensemble des risques auxquels ils sont exposés du fait des activités des autres partenaires, et formation aux mesures de protection à prendre ;
- Enfin, l’indispensable coordination vis-à-vis des exigences applicables aux entreprises extérieures, régie par le Code du travail.
Il s’agit d’engagements contraignants visant à assurer un niveau
maximal de maîtrise des risques à la source, et la désignation
d’un gestionnaire n’exonère pas les exploitants de leur
responsabilité propre, qu’il s’agisse de la sécurité de leur(s)
installation(s) ou de la coopération dans le cadre de ces
opérations collectives de sécurité.
Précisons qu’au vu de ces engagements, le Préfet compétent pourra
prescrire aux partenaires toute mesure propre à améliorer
substantiellement le niveau de protection de la plateforme,
notamment par des mesures de protection, de réduction de la
vulnérabilité ou d'organisation de leurs activités.
Il pourra aussi subordonner l'autorisation d'installations
nouvelles ou l'extension d'installations existantes au sein de la
plateforme, au respect de prescriptions relatives à leur
construction, leur utilisation ou leur exploitation.
Plus généralement, dans le cadre de l’instruction préfectorale de
la demande d’inscription sur la liste des plateformes
industrielles, l’autorité administrative exerce un contrôle et
s’assure que le gestionnaire de plateforme soit effectivement en
mesure de s’acquitter des obligations prévues au contrat de
plateforme, ce qui pose la question des moyens et de
l’organisation.
Sans éluder la responsabilité propre de chaque exploitant, le
gestionnaire désigné sera en effet l’interlocuteur direct de
l’autorité administrative exerçant la police des installations
classées, et pourra être mis en demeure en cas de manquement
constaté dans le périmètre de gestion mutualisée.
Dans tous les cas, le Préfet pourra en outre requérir que le
gestionnaire de la plateforme réalise, à l’échelle de la
plateforme :
- Des évaluations ;
- La mise en œuvre des remèdes rendus nécessaires soit à la suite d’un accident ou incident survenu dans l'installation, soit du fait des conséquences entraînées par l'inobservation de prescriptions, soit en raison de tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Ainsi, les aménagements réglementaires ouverts aux plateformes
industrielles inscrites s’accompagnent d’un renforcement du
maillage sécuritaire, ce qui vient rajouter une strate aux
obligations existantes.
Toutefois, ce dispositif « canevas » laisse finalement aux
exploitants désireux de se regrouper dans ce cadre -ce qui reste
une faculté-, une certaine latitude pour établir leur curseur de
mutualisation et le mode de gouvernance du contrat de plateforme
de manière la plus adaptée à leurs activités.
Cela nécessite toutefois une réflexion profonde ainsi qu’une
ingénierie juridique particulière, compte tenu de la complexité
des rapports noués entre les parties, et des problématiques de
responsabilités diverses qui y sont associées.