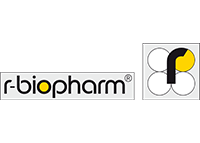Face à une tragédie humaine, il y a forcément un « avant » et un « après » dans l’entreprise, mais mieux vaut éviter de se retrouver dans la situation où comme dit l’adage, on est « toujours plus intelligent après »…
L’enjeu premier de la prévention
D’où l’importance d’agir en prévention avec tous les leviers organisationnels, techniques et humains adaptés.
Le risque d’accident mortel du travail, de par sa gravité, présente un niveau d’ « acceptabilité » nécessairement nul du point de vue de l’évaluation des risques professionnels.
Selon les statistiques publiques *, le nombre d’accidents mortels du travail reste trop élevé avec l’atteinte d’un plancher dans la progression, ce qui a conduit à une campagne nationale de mobilisation autour du Plan de prévention des accidents du travail graves et mortels (Plan ATGM), adossé au 4e Plan Santé Travail (PST4) pour la période 2022-2025.
Sont notamment visés dans ce cadre les catégories de travailleurs réputées vulnérables parce que jeunes et/ou précaires, ainsi que les grands risques : risque routier, équipements de travail, chutes de hauteur (à noter la récente condamnation d’une entreprise pour défaut de prise en compte dans un PPSPS des risques de circulation en hauteur et du danger de chute, ce dont l’employeur « ne pouvait pas ne pas avoir conscience » - Cass. Civ. 2ème 9 janvier 2025, n° 22-24167).
*Pour 2023, le rapport de la CNAMTS dénombrait ainsi 1 287 décès tous sinistres confondus (759 AT, 332 accidents de trajet et 196 décès du fait de maladies professionnelles).
Parmi les AT mortels, plus de la moitié (432) concernaient des malaises (cf. INRS - base de données EPICEA).
Justement sur ce terrain, un renforcement prochain de la réglementation est annoncé pour améliorer la prévention des risques liés au dérèglement climatique, avec notamment une prévention renforcée pour les activités et les situations de travail sur lesquelles les épisodes caniculaires présentent le plus de risques (cf. Plan national d’adaptation au changement climatique PNACC-3 du 10 mars 2025, mesure n° 11).
Parmi les mesures à venir, retenons la volonté d’agir sur les axes suivants :
- De nouvelles obligations réglementaires en matière :
- d’équipements de travail et de lieux de travail pour conserver une ambiance thermique convenable ;
- de coordination de la prévention des risques d’interférence et de coactivité, à la charge des donneurs d’ordre et des maitres d’ouvrage ;
- de vigilance météorologique en cas de prévision d’épisode de chaleur intense ;
- de préparation contre le risque d’exposition des travailleurs aux épisodes de chaleur intense, via des mesures ou d’actions de prévention.
- Des moyens de contrôle administratif dans une logique préventive et dissuasive, permettant aux inspecteurs du travail de pouvoir graduer leur action, jusqu’à l’arrêt temporaire de travaux ou d’activités dans les situations de danger grave et imminent d’exposition de travailleurs à des températures excessives en période de vague de chaleur intense.
- Une adaptation des règles de conception et d’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) en termes de protection contre les risques liés aux effets des vagues de chaleur et d’amélioration de leur ergonomie.
Une extension du régime d’indemnisation chômage-intempéries compte tenu de l’augmentation des aléas climatiques, sachant que légalement, sont considérées comme intempéries « les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir » (L5424-8 CT). Le décret n° 2024-630 du 28 juin 2024 est venu préciser ce qu’il faut entendre par « conditions atmosphériques », à savoir « les périodes de canicule, mais également, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort (D5242-7-1 nouveau CT). Un arrêté ministériel devra encore venir pour préciser les critères de vagues de chaleur ouvrant droit au régime.
Il est aussi question d'élargir la réflexion aux autres secteurs impactés en raison d’une activité en extérieur lors de fortes chaleurs, afin de mettre en place des régimes de prévention et d’accompagnement adaptés et sectoriels (arrêts de travail continuation d’activité, etc.).
Sur les suites de l’accident mortel du travail
Par définition, un accident mortel du travail se situe au plus haut seuil de gravité sur l’échelle de la sinistralité.
Rappelons ici que depuis le 12 juin 2023, tout décès au travail doit donner lieu à une information formalisée auprès de l’inspecteur du travail du lieu de survenance, immédiatement, et au plus tard dans les dans un délai maximum de 12 heures à compter du décès ou du moment où l'employeur a connaissance de celui-ci (R4121-5 CT).
L’objectif étant de permettre une enquête de plus à chaud possible, sachant que l’agent de contrôle est déontologiquement tenu de diligenter en enquête lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, et doit par ailleurs en informer sa hiérarchie et saisir si besoin les autorités compétentes, notamment judiciaires (R8124-28 CT).
A noter que la jurisprudence vient de considérer qu’une enquête pénale insuffisamment approfondie concernant le processus causal entre une exposition à des substances toxiques et un décès professionnel, et conduisant au classement sans suite d’une plainte pour homicide involontaire des ayants droits, constitue une atteinte à l’article 2 de la CEDH, garantissant droit à la vie et imposant aux Etats des exigences procédurales en termes d’effectivité de l’enquête (CEDH 27 mars 2025, n° 30336/22, Laterza c/ Italie).
Selon la politique pénale en vigueur, en cas d’infraction relevée à l’origine d’un accident mortel du travail, l’engagement de poursuites pénales sera systématique (pas de mesures alternatives compte tenu de l’atteinte portée aux valeurs sociales protégées), sur le fondement du Code pénal pour homicide involontaire dans le cadre du travail, et en lien le plus souvent avec l’existence d’une violation d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par la loi ou le règlement.
A côté de l’employeur (personne morale et/ou physique), d’autres coauteurs ou protagonistes peuvent également être mis en cause (entreprise utilisatrice ou extérieure, maître d’ouvrage, etc.).
Typiquement, si l’employeur doit veiller au soutien humain et à l’accompagnement des proches au plan notamment des démarches administratives, il devra également très vite anticiper l’organisation de sa défense sur le terrain de la responsabilité pénale, mais également civile.
Comme pour tout accident du travail, l’enjeu assurantiel occupe une place importante, tant au plan de l’assurance de personnes (le dirigeant mesurera ici tout l’enjeu d’avoir ou non mis en place un régime complémentaire de prévoyance couvrant le décès au bénéfice de ses salariés), que de l’assurance de responsabilité civile d’exploitation (cf. garantie faute inexcusable de l’employeur).
Dans les rapports de l’entreprise avec la Sécurité sociale, deux évolutions récentes sont en outre à relever :
Par un revirement de jurisprudence, il vient d’être jugé que la communication à l’employeur du rapport d’autopsie (L442-4 CSS) n’est pas obligatoire pour la CPAM dans le cadre de son instruction, en sorte que l’employeur n’est pas fondé à invoquer l’existence d’une irrégularité de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel (Cass. Civ. 2ème 3 avril 2025, n° 22-22634) ;
Concernant la tarification ATMP, à compter du 17 avril 2025, l’imputation par la CARSAT au compte employeur du coût d’un AT/MP mortel sur la période triennale de référence interviendra à la date, non plus de la survenance du décès, mais de la notification de la reconnaissance de son caractère professionnel (D242-6-6, 2° CSS, modifié par décret n° 2025-342 du 15 avril 2025).
Ce type d’accident met en œuvre des mécanismes juridiques complexes et place les parties prenantes dans une temporalité nécessairement longue et déphasée par rapport à leur réalité (que ce soit pour les proches ou l’entreprise), qui nécessite un accompagnement adapté.